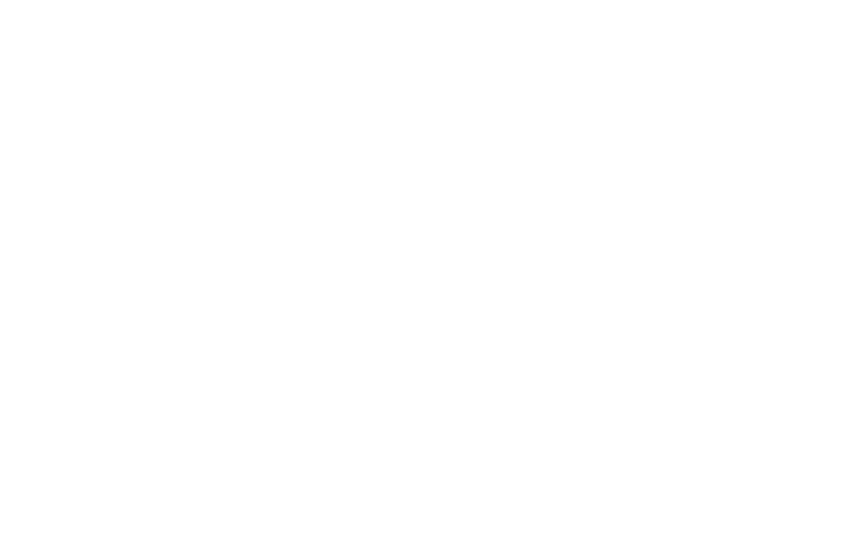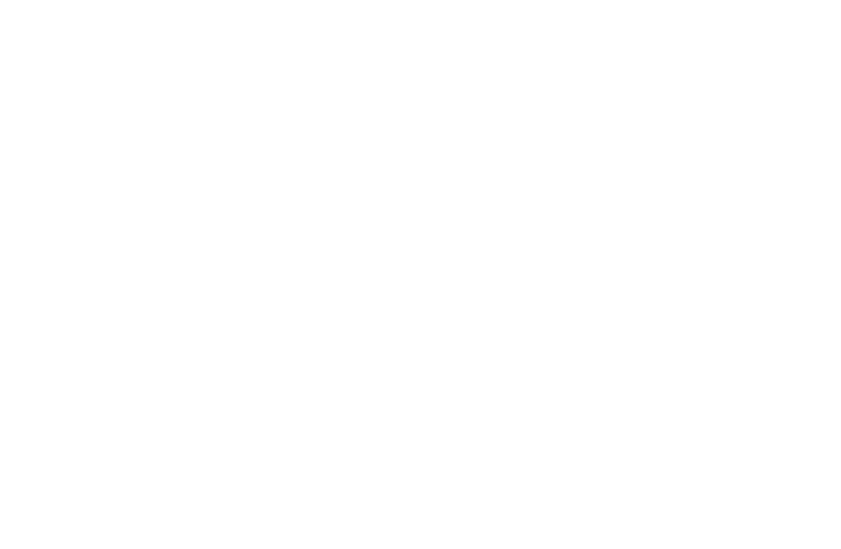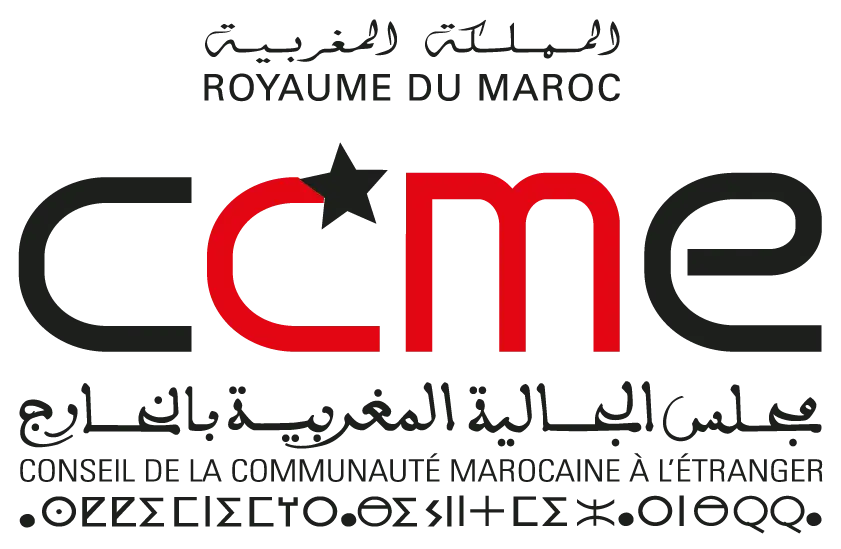Quatre maires de grandes villes seulement sur 260… Les Français issus des minorités visibles restent massivement exclus des charges politiques.
«Après Anne Hidalgo à Paris, Londres sur le point d’élire un maire issu de l’immigration ?» a tweeté lundi le conseiller presse de la socialiste. Certes, on peut faire grâce à l’édile parisienne, tout comme au Premier ministre, Manuel Valls, d’être née en Espagne avant d’avoir été naturalisée française des années plus tard. On peut de même reconnaître à Nicolas Sarkozy, dont le père est un immigré hongrois, d’être «un Français de sang mêlé» comme il aimait à le rappeler. Mais leur condition n’a pas grand-chose à voir avec celle des «minorités visibles», issues de l’immigration maghrébine et africaine, souvent depuis plusieurs générations. Les cas Hidalgo, Valls ou Sarkozy n’ont rien de commun avec celui de l’Anglais Sadiq Khan, d’origine pakistanaise, de confession musulmane et favori de la municipale londonienne. Ni même avec celui de Barack Obama, premier Noir à la tête des Etats-Unis, où la violence raciste reste une réalité tenace.
«A priori». Dans la France politique de 2016, les «minorités visibles» ne répondent qu’à la moitié de leur définition : elles sont bel et bien «minoritaires» mais leur «visibilité», elle, reste confidentielle parmi les élus de notre pays. Il y a deux ans, seuls quatre candidats issus de la diversité sont devenus maire d’une des 260 villes de plus de 30 000 habitants. Dans le VIIe arrondissement de Paris, Rachida Dati a, pour sa part, gardé ses 58 000 administrés ; et la sénatrice PS Samia Ghali son 8e secteur de Marseille, 100 000 habitants. La députée socialiste Hélène Geoffroy, non pas immigrée mais d’origine guadeloupéenne (et aujourd’hui au gouvernement), l’a, elle, emporté à Vaulx-en-Velin (Rhône), 43 000 habitants, tandis qu’Azzedine Taïbi (PCF), d’origine algérienne, est, lui, devenu maire de Stains (Seine-Saint-Denis), commune de 35 000 habitants. Autant de cas isolés. Encore plus singulier : Mariéme Tamata-Varin, d’origine mauritanienne, est devenue maire de la petite commune de Yèbles (Seine-et-Marne), 700 habitants. La seule à être à la fois femme, noire et de confession musulmane. Une première. «On a enfin réussi à bousculer les a priori, s’était-elle réjouie au soir de sa victoire. Les gens s’imaginaient que ce n’était pas possible. Mais si !»
Au terme des municipales de 2014, le politologue Gilles Kepel avait noté qu’«il n’y a toujours pas de raz-de-marée», mais pas non plus de reflux de la diversité. Entre 2001 et 2008, selon une étude de feu le Haut Conseil à l’intégration, le nombre de candidats issus de l’immigration extra-européenne ayant intégré les conseils municipaux des villes de plus de 9 000 habitants était passé de 1 069 à 2 343. Soit 6,68 % du total de ces élus mais pour seulement neuf maires à l’arrivée. Auteur de Passion française (Gallimard), une enquête sur les descendants d’immigrés candidats aux législatives de 2012, Gilles Kepel a décrit une progression qui a commencé selon lui après les émeutes urbaines de 2005 : dans les banlieues, de nombreux jeunes avaient pris leur carte d’électeur pour faire barrage à Sarkozy et son Kärcher, avant, pour certains, d’intégrer des listes municipales en 2008, à droite comme à gauche. Notamment parce que les maires sortants et les candidats en conquête voulaient avoir des «relais» dans les quartiers. Mais c’est précisément pour cette raison que de nombreux candidats de la diversité ont jeté l’éponge après une première expérience durant laquelle ils ont été, ou ont eu le sentiment d’être, cantonnés au statut d’«Arabes de service», de représentants des quartiers, au mieux adjoints à «l’égalité» ou à la vie associative. Quelque chose qui a à voir avec l’assignation identitaire, carburant au communautarisme davantage qu’au multiculturalisme.
Marketing. Historiquement, il y a pourtant la Manche et même un monde entre le communautarisme anglo-saxon décomplexé et la tradition universaliste française qui refuse, au nom de la République, la reconnaissance des communautés et la discrimination positive (hors parité).
Principal promoteur du concept de diversité, Nicolas Sarkozy en avait fait en 2007 un atout de marketing électoral : à l’époque, il intégrait dans le premier gouvernement Fillon des personnalités comme Rachida Dati, Rama Yade ou Fadela Amara, sans parcours militant (pour les deux premières) ni implantation électorale. Mais à droite, au-delà des municipales de 2008 et de quelques cas isolés, la question de la diversité dans le champ politique est (re)devenue marginale à mesure que la «buissonisation» des esprits a gangrené le sarkozysme des origines.
Le fait que la droite promeuve un temps la diversité a en tout cas forcé la gauche à se positionner. Mais si François Hollande a nommé ministre Najat Vallaud-Belkacem (Education) ou Myriam El Khomri (Travail), elles détestent être réduites à leurs origines. Elles sont des symboles au sommet de la société, mais c’est à la base que la diversité doit avoir droit de cité pour devenir une réalité visible et durable. Reste qu’entre le risque de se faire accuser de communautarisme électoral et le contexte de poussée du FN, à une époque où les amalgames sont légion, la diversité n’a pas le vent en poupe. Cela pourrait durer, au moins jusqu’à ce que les électeurs de la diversité votent en masse.
5 mai 2016, Jonathan Bouchet-Petersen
Source : Libération