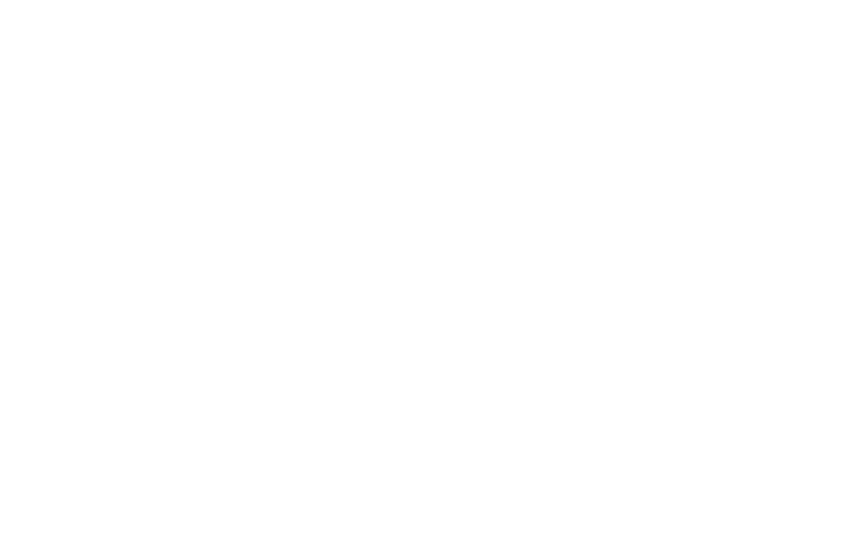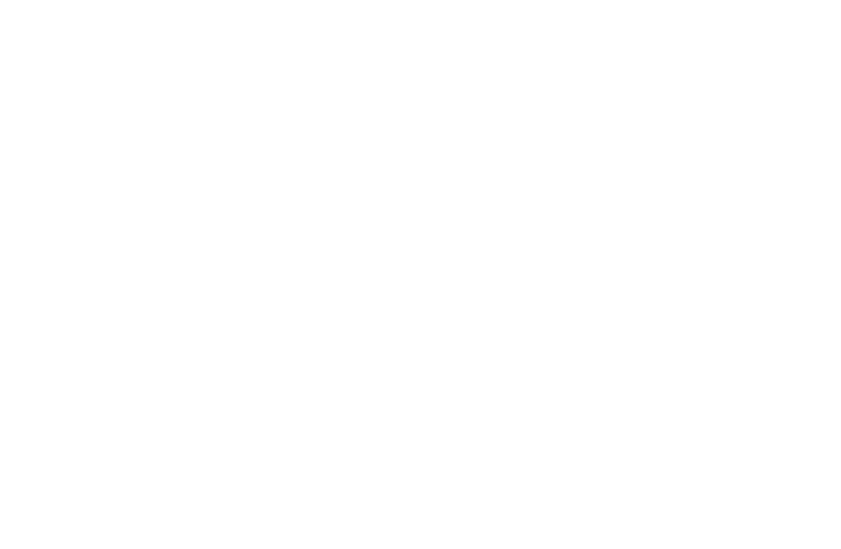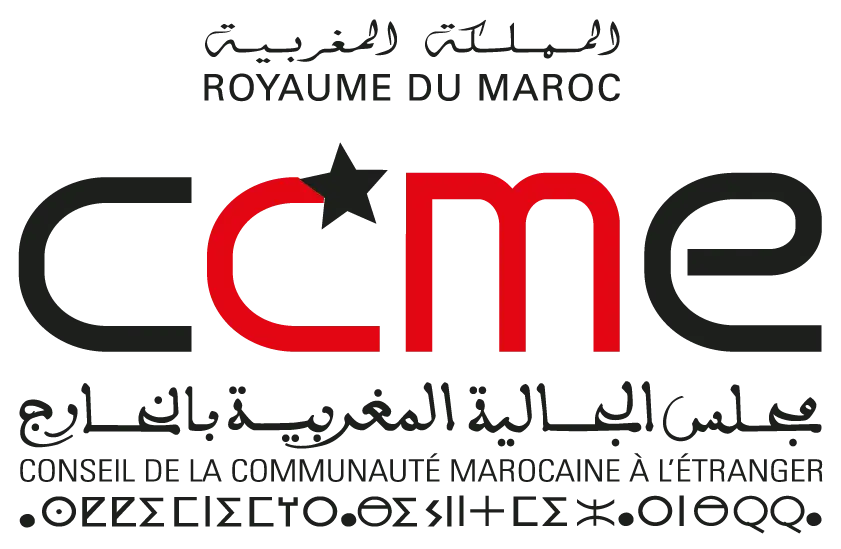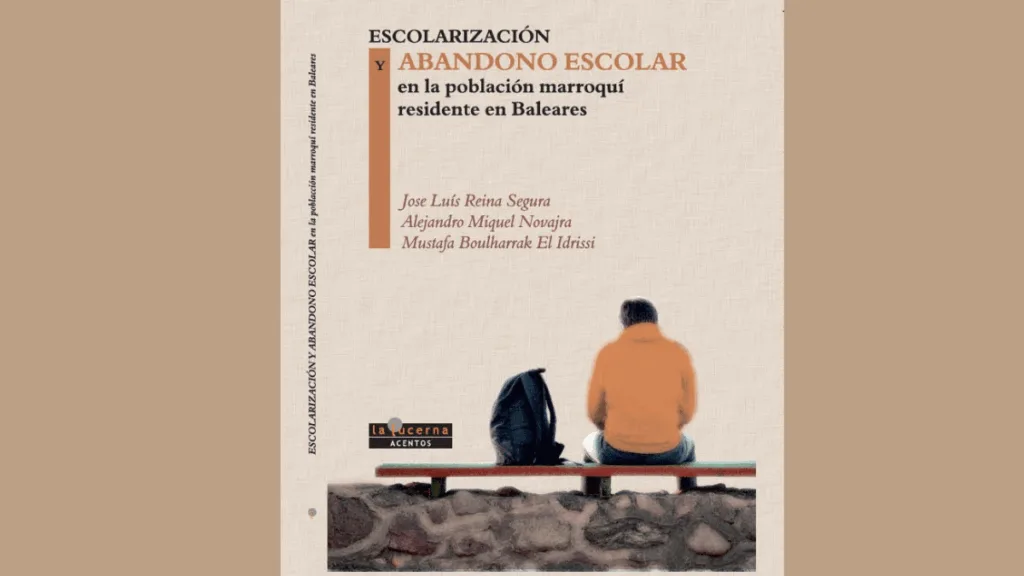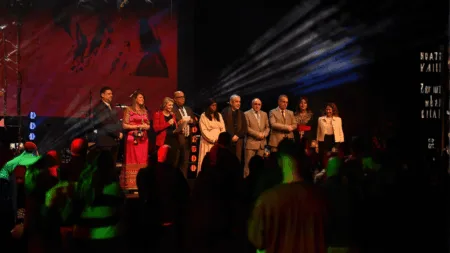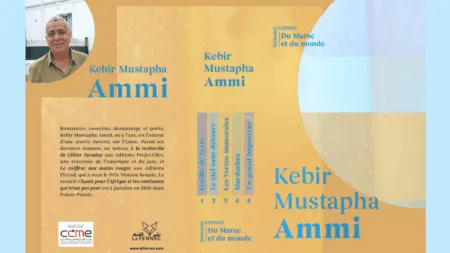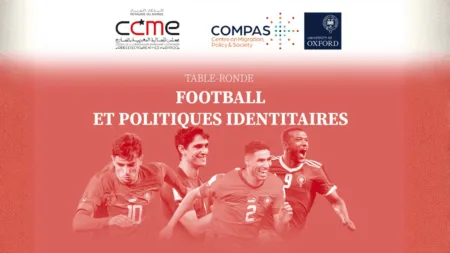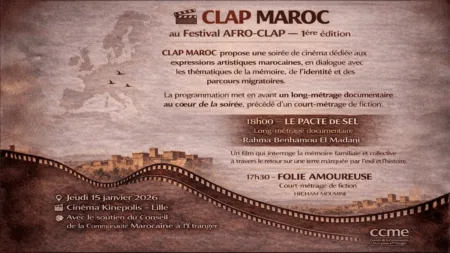Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger participe, jeudi 30 octobre 2025 aux Îles Baléares, à la conférence de presse de présentation d’une étude scientifique sur la scolarisation et l’abandon scolaire des enfants de migrants marocains.
L’étude examine la situation éducative des enfants marocains résidant aux îles Baléares, où vivent environ quarante mille Marocains, constituant le deuxième groupe étranger après les Allemands. Elle fait suite à une enquête réalisée par le CCME en 2015 qui avait révélé des problèmes préoccupants : un faible engagement parental dans le suivi scolaire, des taux élevés d’absentéisme et d’abandon, et une faible scolarisation des jeunes enfants. Les dix années écoulées ont cependant permis d’observer une amélioration considérable de la situation, lit-on dans le document de présentation de cette étude.
En effet, entre 2010 et 2022, le nombre d’élèves marocains a explosé de 165%, tandis que la population marocaine totale n’augmentait que de 121%. Cette croissance est particulièrement marquée dans les cycles de maternelle et de primaire, avec des augmentations respectives de 91,79% et 94,97%, contre seulement 8,37% et 5,59% pour l’ensemble des élèves des Baléares. En 2022, 6 723 élèves marocains étaient scolarisés, représentant 23,2% de la population marocaine totale. Les données quantitatives de 2024 montrent tout de même que les Baléares affichent le deuxième taux d’abandon scolaire précoce le plus élevé d’Espagne avec 18,2%.
Dans l’enseignement secondaire et professionnel, la progression reste significative mais révèle des disparités importantes. L’enseignement professionnel de niveau intermédiaire a vu ses effectifs marocains augmenter de 169%, avec une présence féminine majoritaire de 51,38%. Les choix de spécialités suivent des schémas genrés traditionnels : les filles privilégient la gestion administrative, la pharmacie et l’aide aux personnes handicapées, tandis que les garçons s’orientent vers les installations électriques, la cuisine et la mécanique automobile. Dans l’enseignement professionnel supérieur, la progression est encore plus spectaculaire avec une augmentation de 652% entre 2010 et 2023, et les femmes y sont encore plus représentées avec 57,57% des effectifs, témoignant d’une plus grande persévérance dans la poursuite des études.
D’un côté, l’étude observe que le décrochage scolaire précoce devient particulièrement visible dans l’enseignement post-obligatoire. En 2023, seulement 7,48% des élèves marocains poursuivaient leurs études après l’enseignement obligatoire, contre 17,71% pour l’ensemble des élèves des Baléares, soit plus du double. Au niveau du baccalauréat, bien que les effectifs aient doublé entre 2010 et 2023, passant de 72 à 149 élèves, ils restent numériquement très faibles. Les femmes y sont largement majoritaires avec 62,63% des effectifs.
L’accès à l’université demeure aussi extrêmement limité : entre 2010 et 2021, seulement 138 étudiants marocains se sont inscrits à l’Université des Îles Baléares sur un total de 33 263, soit à peine 0,42%. Le taux d’abandon universitaire atteint 49,28%, signifiant que seul un étudiant sur deux termine son cursus. Plus parlant encore, sur cent élèves marocains terminant l’enseignement secondaire obligatoire, seulement trois parviennent à achever des études universitaires.
Selon l’équipe de recherche, quatre dimensions principales expliquent le décrochage scolaire : les facteurs personnels, le contexte familial, la dimension sociale et le système éducatif. Les chercheurs soulignent particulièrement le rôle de la xénophobie et des discriminations dans ce décrochage, qui se manifestent dans le durcissement des lois sur l’immigration. Le système éducatif lui-même est critiqué pour son incapacité à gérer la diversité culturelle, à motiver les élèves et à leur offrir suffisamment d’alternatives pour les études post-obligatoires. Les établissements manquent de ressources et les enseignants de formation pour faire face à cette diversité.
Par ailleurs, les chercheurs soulèvent deux questions particulièrement problématiques qui ont émergé des entretiens. La première concerne la répartition inégale des élèves étrangers entre les établissements scolaires, qui tend à concentrer les élèves marocains dans des écoles dévalorisées, soit en raison de quartiers à forte concentration d’étrangers, soit par manque de places dans les établissements de proximité. La seconde touche à l’orientation systématique des élèves marocains vers la formation professionnelle plutôt que vers des études académiques, perçue comme discriminatoire.
Les recommandations de l’étude insistent sur la nécessité d’une approche conjointe impliquant la communauté éducative, les parents et les institutions intervenant dès l’école primaire pour garantir l’égalité entre les élèves. Les recherches soulignent également qu’il est essentiel de renforcer les programmes de tutorat et de soutien scolaire, d’augmenter la participation parentale, d’améliorer l’orientation scolaire et professionnelle en y incluant les familles, et de former les enseignants à la gestion de la diversité culturelle.
L’étude soulève également des questions connexes qui pourraient contribuer à réduire le décrochage scolaire : le décalage entre les associations des mosquées, concentrées sur l’enseignement de la langue et de la culture arabes, et les établissements scolaires peut créer des situations d’inadaptation, d’absentéisme ou de rejet lors d’activités extrascolaires. Un contact plus fluide entre la communauté éducative, les travailleurs sociaux et les associations pourrait clarifier ces tensions.
L’étude déplore aussi la faiblesse de l’associationnisme au sein de la communauté marocaine, qui malgré son importance numérique, manque de moyens pour se faire entendre et défendre ses intérêts. La disparition du Forum des Baléares sur l’immigration, remplacé par un Conseil consultatif dilué qui se réunit seulement deux fois par an, prive la communauté d’un espace de dialogue avec les administrations publiques. Cette absence de représentation reste difficile à expliquer dans une région où les étrangers représentent 21,65% de la population, le taux le plus élevé d’Espagne.
CCME